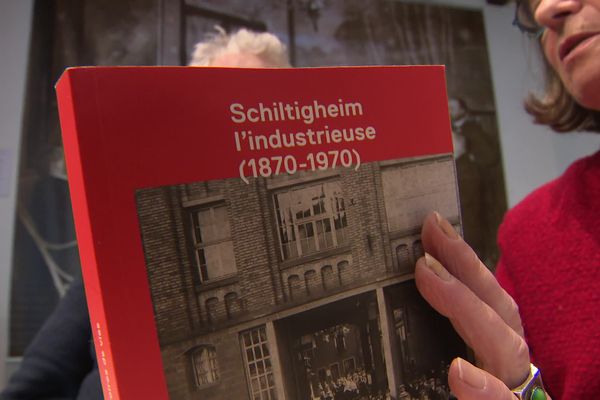Schiltigheim a longtemps été connue comme la "cité des brasseurs", avant la fermeture des brasseries les unes après les autres. Mais la commune a aussi connu un âge d'or industriel, jusque dans les années 1970. Quelques passionnés de patrimoine l'ont retracé dans un livre de témoignages, "Schiltigheim, l'industrieuse".
L'on vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Celui de l'âge d'or industriel de Schiltigheim. Car par le passé, la cité voisine de Strasbourg, souvent éclipsée par celle-ci, a beaucoup attiré, et créé beaucoup d'emploi. Sa population a même quadruplé entre 1870 et 1930. Andrée Buchmann, adjointe à la maire en charge du patrimoine, insiste : "Il y avait beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières. Aujourd'hui encore, cette culture ouvrière perdure ; on se parle facilement à Schiltigheim, cet esprit-là existe toujours."
A l'origine de ce succès, bien sûr, les cinq brasseries qui en leur temps, font la renommée de la cité des brasseurs: Fischer, Adelshoffen, Perle, Schutzenberger, l'Espérance (aujourd'hui Heineken). Aujourd'hui, toutes ont, ou vont, fermer (Heineken devrait fermer ses portes fin 2025, ndlr). Entre 1870 et 1970, ce contexte économique florissant attire aussi d'autres industries, telles que la tonnellerie Frühinsholz, le fabricant de machines frigorifiques Quiri ou encore la grande conserverie Ungemach.
Un passé plus ou moins vivace
Mais aussi, les ateliers de couture, au nombre de quatre, dans la ville. De ce passé, Anne-Louise Itzel garde des souvenirs assez vivaces. Dans la rue Principale, elle nous mène dans la cour d'un immeuble, autrefois dédié à la coupe et la couture de tissus. "C'était l'entreprise Mastra. Le bâtiment rouge, là, était un hangar de stockage. J'ai d'abord travaillé derrière une machine à coudre, mais comme j'étais trop rapide, on m'a mise à la coupe, dans l'autre bâtiment, au troisième étage." D'un pas mesuré, l'indéboulonnable Schilikoise nous mène vers la maison à la façade décorée, imaginée par l'architecte Franz Scheyder au début du 20e siècle. "Au premier étage, il y avait un atelier de couture, là aussi". Il n'en reste plus rien.
Du passé brassicole, en revanche, restent bon nombre de documents, d'affiches, de photos et d'écrits, conservés précieusement dans le petit musée de l'ancienne Ferme Linck, géré par l'association Mémoire et Patrimoine. Sur plusieurs étages, le visiteur replonge dans le passé prolifique de Schiltigheim. Celui des patrons paternalistes, parfois intimidants, comme René Hatt, ancien directeur de la brasserie l'Espérance, dont le portrait trône dans une salle. Ces patrons qui ont "fait construire de belles usines, comme des cathédrales", explique Jean-Pierre Nafziger, président de Mémoire et Patrimoine. Et puis, l'on y trouve encore de vieux menus des soirées organisées par le fabricant de foies gras Auguste Michel, créateur du "Kunschthafe" (marmite artistique), cercle d'intellectuels à l'origine du renouveau de la culture alsacienne à la fin du 19e siècle.
Un livre de récits et témoignages
Ce passé-là, quelques bénévoles de l'association ont voulu le retranscrire, sous l'impulsion d'Andrée Buchmann. En quelques années de travail, ils ont collecté des récits d'habitants, d'historiens, de travailleurs et de patrons, pour en faire un livre : "Schiltigheim, l'industrieuse (1870-1970)", publié fin décembre 2024. L'on y trouve, entre autres, celui du maître brasseur Patrick Gauger, employé de feu Michel Debus durant des décennies. Celui de Jean-Jacques Risch, fils de l'architecte Henri Risch, constructeur des premiers "habitats à bon marché" dans les années 1930, cité HLM aujourd'hui encore bien conservée. Ou encore celui de l'adjoint au maire Patrick Maciejewski, qui retrace l'histoire des nombreuses galeries souterraines schilikoises, destinées en leur temps à conserver les blocs de glace pour la fabrication de la bière. Le passé glorieux et complet de l'ancienne "capitale de la bière", en 280 pages.
"Schiltigheim, l'industrieuse (1870-1970)", Un bout de chemin Editions, prix : 28 euros